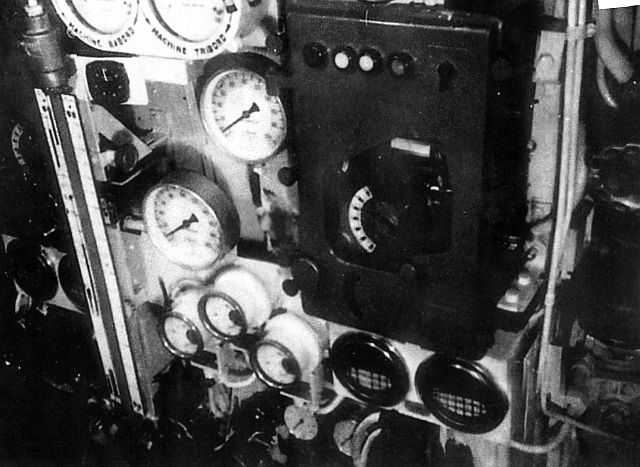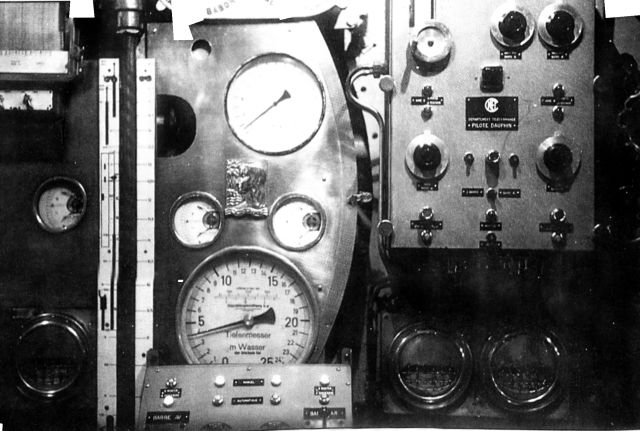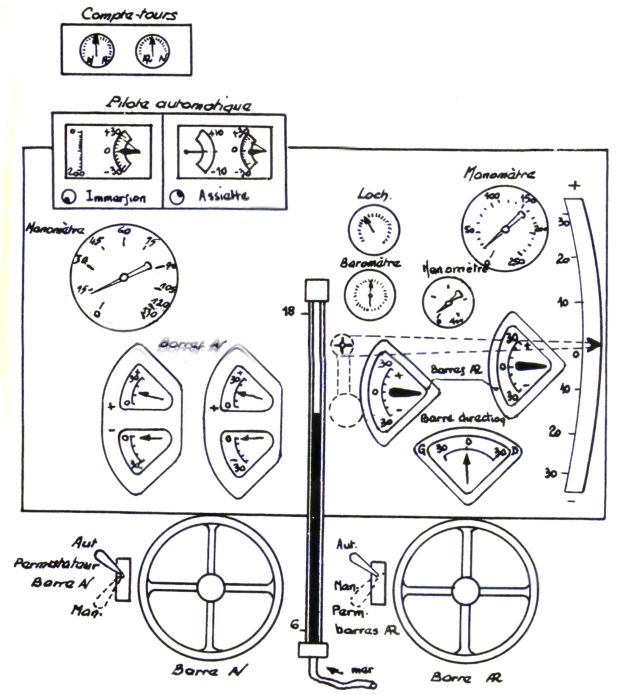Pilote Tuschka
Pilote Tuschka de l'Espadon
- L'Oberingenieur Friedrich Tuschka avait
travaillé pour la firme Askania de Berlin-Friednau
dès 1937. Ingénieur, puis ingénieur en chef,
il avait occupé de nombreux postes et gravi
progressivement les échelons de la hiérarchie au
sein de cette firme spécialisée dans l'étude
et la fabrication des systèmes de guidage, des commandes
hydrauliques et autres dispositifs de précision : la firme
Askania avait ainsi produit pour le compte de la Luftwaffe
des pilotes automatique pour les avions. Pendant la guerre, le
docteur Kurt Wilde, un des collaborateurs de l'Oberingenieur
Tuschka s'était signalé par le développement
du pilote automatique de la bombe volante Fieseler Fi 103/V1 . En 1939, la firme
avait également étudié pour le compte de
l'armée de Terre un système de pilotage pour les
fusées A4/V2
. En 1939, la firme
avait également étudié pour le compte de
l'armée de Terre un système de pilotage pour les
fusées A4/V2 utilisant des
gyroscopes. Ce dernier fut cependant abandonné au profit
de celui d'une firme concurrente, Kreiselgeräte GmbH. Ses
activités dans le domaine du guidage et des installations
hydrauliques avaient eu bien entendu des retombées dans le
domaine de la construction navale, en particulier dans la
construction des sous-marins et des torpilles : Askania avait
ainsi été amenée à réaliser
des appareils de tenue automatique de l'immersion, des appareils
de tenue automatique de pesée, des commandes hydrauliques
de périscope, de gouvernail, des traceurs de route,
différents organes de torpille, des moteurs de gouvernail
à air comprimé. À la suite des bombardements
successifs de Berlin en 1943, la section de l'Oberingenieur
Friedrich Tuschka, qui comprenait un bureau d'études et de
calculs, un laboratoire pour organes de réglages et de
mesures, ainsi qu'un atelier, avait été
délocalisée à Greiffenberg, petite ville de
Silésie. Devant l'avancée soviétique, la
direction de la firme Askania avait cependant
évacué une partie du personnel de Greiffenberg vers
Senthofen, dans l'Allgau, région autrichienne
occupée par la 1ère Armée française.
Au titre des réparations, les installations de Senthofen
furent saisies par l'armée française tandis que
l'Oberingenieur Friedrich Tuschka et une partie de es
collaborateurs furent recrutés par la Mission technique
permanente de la Marine nationale en Zone française
d'occupation. Dans un mémorandum de 1946, Friedrich
Tuschka décrivit avantageusement ses travaux au Service
technique des constructions et armes navales, par lequel il avait
été recruté, et ajouta les précisions
suivantes:
utilisant des
gyroscopes. Ce dernier fut cependant abandonné au profit
de celui d'une firme concurrente, Kreiselgeräte GmbH. Ses
activités dans le domaine du guidage et des installations
hydrauliques avaient eu bien entendu des retombées dans le
domaine de la construction navale, en particulier dans la
construction des sous-marins et des torpilles : Askania avait
ainsi été amenée à réaliser
des appareils de tenue automatique de l'immersion, des appareils
de tenue automatique de pesée, des commandes hydrauliques
de périscope, de gouvernail, des traceurs de route,
différents organes de torpille, des moteurs de gouvernail
à air comprimé. À la suite des bombardements
successifs de Berlin en 1943, la section de l'Oberingenieur
Friedrich Tuschka, qui comprenait un bureau d'études et de
calculs, un laboratoire pour organes de réglages et de
mesures, ainsi qu'un atelier, avait été
délocalisée à Greiffenberg, petite ville de
Silésie. Devant l'avancée soviétique, la
direction de la firme Askania avait cependant
évacué une partie du personnel de Greiffenberg vers
Senthofen, dans l'Allgau, région autrichienne
occupée par la 1ère Armée française.
Au titre des réparations, les installations de Senthofen
furent saisies par l'armée française tandis que
l'Oberingenieur Friedrich Tuschka et une partie de es
collaborateurs furent recrutés par la Mission technique
permanente de la Marine nationale en Zone française
d'occupation. Dans un mémorandum de 1946, Friedrich
Tuschka décrivit avantageusement ses travaux au Service
technique des constructions et armes navales, par lequel il avait
été recruté, et ajouta les précisions
suivantes:
" Pratiquement la totalité des usines Askania
ainsi que leurs plans, modèles, dossiers, etc ... ont
été confisqués et emmenés par
l'Armée rouge. La totalité de mes dossiers a
également disparu. Tous les appareils doivent être
reconstitués de mémoire ; seuls les quelques hommes
qui ont l'expérience sont capables de le faire. ( ... ). A
l'heure actuelle, mes systèmes de commandes automatiques
sont fabriqués chez les Russes et chez les
Anglais."
- Parmi les systèmes étudiés sous la
direction de l'Oberingenieur Tuschka, ce fut l'appareil de tenue
automatique de l'immersion qui retint principalement l'attention
des ingénieurs français du STCAN. Ce dernier fit
installer un petit bureau d'études à Bad Jungbrunn,
une localité située près de Linz en
Autriche. En septembre 1946, l'Oberingenieur Tuschka acheva une
première étude théorique visant à
établir le bilan critique de ses travaux antérieurs
et à définir les grands principes de
fonctionnements d'une nouvelle commande de tenue automatique de
l'immersion. Il estimait en effet que les commandes construites
durant la guerre avaient été
réalisées avec trop de hâte et
présentaient encore des défauts. L'étude du
premier dispositif remontait à 1937 et était
à relier aux travaux de la firme Walter sur les
sous-marins rapides. Sur un sous-marin dont la vitesse en
plongée devait dépasser les 25 nœuds, il
était prévisible que le maintien de l'immersion
deviendrait de plus en plus difficile et un véritable
changement de mentalité devait être effectué
en la matière. Un premier système, destiné
au petit sous-marin Walter expérimental V80 et mettant en jeu de gyroscopes et des
composants issus des études aéronautiques fut
testé en laboratoire en 1941. Jugé insuffisant, il
ne serait cependant jamais installé à bord: si la
course du sous-marin avait effectivement pu être maintenue,
l'immersion et ses variations n'étaient pas prises en
compte. L'expérience acquise permit toutefois le
développement d'un système entièrement
nouveau baptisé commande NT - Neigung und
Tiefensteuerung (assiette et immersion). Le premier composant
de la commande NT était un tuyautage de mesure aboutissant
à une chambre à membrane. À
l'intérieur de cette dernière, la pression
compressait une membrane dite d'immersion et mettait un ressort
sous tension. Le maintien de l'immersion était
opéré par réglage de la tension du ressort.
Les variations d'immersion pouvaient être
opérées entre 10 et 150 mètres, avec un
écart possible de 2 mètres. Quant à
l'assiette du sous-marin, elle était tout simplement
contrôlée grâce à un système de
pendule placé sur des suspensions à ressort afin de
résister aux grenadages. Les données recueillies
par ces deux appareils étaient transmises à de
engrenage calculateur eux-mêmes reliés au gouvernail
et aux barres de plongée. Ces engrenages calculateur
constituaient le cœur de la commande NT et furent l'objet
d'une mise au point délicate, en particulier celui
appelé système à avance, qui
générait une dérivée - et permettait
d'appréhender une situation au vu de
l'accélération du mouvement. Grâce à
la commande NT, le sous-marin pouvait efficacement maintenir ou
modifier son immersion à diverses allures. L'U-555, un sous-marin du type VII
C, fut le premier navire à recevoir en 1942 cette commande
expérimentale. À cette même période,
l'utilité d'un appareil de tenue automatique de
l'immersion augmenta, les sous-marins allemands étant
contraints d'évoluer en plongée d'une
manière croissante. En permettant aux sous-marins de
recharger leurs batteries électriques ou de transiter en
plongée, l'adoption du Schnorchel avait
confirmé cette évolution mais impliquait une charge
de travail accrue et particulièrement épuisante
pour le personnel chargé du maniement des barre de
plongée avant et arrière du sous-marin. Lors de la
navigation au Schnorchel, il fallait pouvoir maintenir
durant de longues heures le sous-marin à une immersion
constante, ou tout au plus avec des variations maximum de 0,50
mètre. Si la tête du Schnorchel
émergeait d'une manière trop importante au-dessus
des vagues, elle pouvait être plus facilement
détectée par un radar et révéler la
position du sous-marin. Un second modèle de commande NT
fut ensuite étudié pour les sous-marins des Types
XXI et XXIII. Dans la mesure où, pour une vitesse
supérieure à 6 nœuds, les seules barres de
plongée arrière suffisaient à modifier
l'immersion efficacement, les barres avant devenaient inutiles et
étaient rétractées dans le cas du Type XXI,
soit mises en position neutre et immobilisées comme sur le
Type XXIII. Cette disposition répondait également
au souci de diminuer la résistance à l'avancement
et de gagner quelques nœuds. La nouvelle commande NT fut
donc reliée au dispositif de déploiement des barres
de plongée avant.
et mettant en jeu de gyroscopes et des
composants issus des études aéronautiques fut
testé en laboratoire en 1941. Jugé insuffisant, il
ne serait cependant jamais installé à bord: si la
course du sous-marin avait effectivement pu être maintenue,
l'immersion et ses variations n'étaient pas prises en
compte. L'expérience acquise permit toutefois le
développement d'un système entièrement
nouveau baptisé commande NT - Neigung und
Tiefensteuerung (assiette et immersion). Le premier composant
de la commande NT était un tuyautage de mesure aboutissant
à une chambre à membrane. À
l'intérieur de cette dernière, la pression
compressait une membrane dite d'immersion et mettait un ressort
sous tension. Le maintien de l'immersion était
opéré par réglage de la tension du ressort.
Les variations d'immersion pouvaient être
opérées entre 10 et 150 mètres, avec un
écart possible de 2 mètres. Quant à
l'assiette du sous-marin, elle était tout simplement
contrôlée grâce à un système de
pendule placé sur des suspensions à ressort afin de
résister aux grenadages. Les données recueillies
par ces deux appareils étaient transmises à de
engrenage calculateur eux-mêmes reliés au gouvernail
et aux barres de plongée. Ces engrenages calculateur
constituaient le cœur de la commande NT et furent l'objet
d'une mise au point délicate, en particulier celui
appelé système à avance, qui
générait une dérivée - et permettait
d'appréhender une situation au vu de
l'accélération du mouvement. Grâce à
la commande NT, le sous-marin pouvait efficacement maintenir ou
modifier son immersion à diverses allures. L'U-555, un sous-marin du type VII
C, fut le premier navire à recevoir en 1942 cette commande
expérimentale. À cette même période,
l'utilité d'un appareil de tenue automatique de
l'immersion augmenta, les sous-marins allemands étant
contraints d'évoluer en plongée d'une
manière croissante. En permettant aux sous-marins de
recharger leurs batteries électriques ou de transiter en
plongée, l'adoption du Schnorchel avait
confirmé cette évolution mais impliquait une charge
de travail accrue et particulièrement épuisante
pour le personnel chargé du maniement des barre de
plongée avant et arrière du sous-marin. Lors de la
navigation au Schnorchel, il fallait pouvoir maintenir
durant de longues heures le sous-marin à une immersion
constante, ou tout au plus avec des variations maximum de 0,50
mètre. Si la tête du Schnorchel
émergeait d'une manière trop importante au-dessus
des vagues, elle pouvait être plus facilement
détectée par un radar et révéler la
position du sous-marin. Un second modèle de commande NT
fut ensuite étudié pour les sous-marins des Types
XXI et XXIII. Dans la mesure où, pour une vitesse
supérieure à 6 nœuds, les seules barres de
plongée arrière suffisaient à modifier
l'immersion efficacement, les barres avant devenaient inutiles et
étaient rétractées dans le cas du Type XXI,
soit mises en position neutre et immobilisées comme sur le
Type XXIII. Cette disposition répondait également
au souci de diminuer la résistance à l'avancement
et de gagner quelques nœuds. La nouvelle commande NT fut
donc reliée au dispositif de déploiement des barres
de plongée avant.
- Cette commande électromécanique destinée
aux sous-marins rapides était également plus
complexe que la première commande. Elle servit de base
à la conception du Pilote automatique (PA) dont la
réalisation avait été commandée par
le STCAN. Une des premières étapes de ce travail
fut la recherche de paramètres en conditions
réelles. L'ingénieur Tuschka, dont le groupe
d'études avait été installé à
Überlingen, sur les bords du lac de Constance, se rendit
ainsi à Toulon les 14 et 15 Octobre 1947 afin de
réaliser des expériences d'oscillation à
bord du sous-marin La Créole : elles consistaient
à donner au bâtiment en plongée une impulsion
à l'aide des barres arrière. Une fois le mouvement
acquis, les barres étaient remises à zéro et
les mesures d'assiette et d'immersion effectuées toutes
les 5 ou 10 secondes. L'ingénieur principal du
Génie maritime Jourdain, adjoint au chef de la Section
Sous-marins du STCAN à l'époque, se souvient de ces
expériences réalisées à Toulon avec
l'ingénieur allemand Tuschka:
"( ... ) j'ai embarqué avec lui sur le sous-marin
La Créole alors en essais et nous avons fait diverses
manœuvres qui nous ont amenés tantôt au
voisinage de I' immersion limite, tantôt en surface, avec
la désapprobation du commandant ".
Les conditions dans lesquelles se poursuivit le travail de
l'Oberingenieur Tuschka sont encore obscures, mais on peut
affirmer qu'en 1955, une première version fut
installée à bord du sous-marin La
Créole et soumise à de nombreux essais.
L'appareil Tuschka n° 1 fut ensuite essayé en route
libre à partir de Juillet 1955 à bord du sous-marin
L'Artémis. En Septembre 1955,
alors que ce dernier procédait aux essais
d'équipements, dont le PA Tuschka, destinés aux
nouveaux sous-marins Type Narval, se produisit d'ailleurs
un incident mémorable pour on équipage. Le
sous-marin naviguait au Schnorchel depuis plusieurs heures
lorsqu'une avarie de barre arrière se produisit. Monsieur
Jacques Derny, officier marinier chargé de la
détection sous-marine, était de quart ce moment
précis au Central-Informations (CI), et a bien voulu
relater par écrit cet incident qui aurait pu être
fatal au sous-marin. Ce local étant attenant au
Central-Opérations (CO), où se trouvaient les
équipements de «
Sécurité-Plongée » servant à la
conduite du sous-marin, il en fut le témoin
privilégié. Privé de barre arrière le
sous-marin prit immédiatement une assiette négative
de 12 à 20 degrés. L'officier de quart au CO donna,
comme la procédure l'exigeait, l'ordre « Alerte
Schnorchel » : les sectionnements de coque - circuit
d'aspiration d'air frais, échappements, circuit de
réfrigération - furent isolés pour
empêcher toute rentrée d'eau et les diesels furent
stoppés. Les moteurs électriques furent
démarrés et mis « en avant 4 » pour
compenser la traînée hydrodynamique engendrée
par les mâts encore hissés. Parallèlement,
l'incident fut annoncé sur l'interphone du bord, afin que
le personnel du poste arrière puisse effectuer le
débrayage du moteur électrique commandant la barre
mise en cause et embrayer la barre de secours à bras.
Enfin, la caisse de plongée rapide bâbord, dans
laquelle l'eau de mer entrée dan le circuit
Schnorchel était automatiquement
récupérée, fut vidangée par une
chasse à haute pression. Une fois l'opération
effectuée, l'officier de quart ordonna de réduire
la vitesse des moteurs électriques de 4 à 2. La
confusion régnant à bord, le personnel devant se
cramponner aux divers équipements, l'ordre ne fut pas
perçu et le sous-marin, dont la pointe négative
atteignait maintenant 30°, continua à descendre
« en avant 4 ». En s'accrochant à ce qu'ils
pouvaient, le lieutenant de vaisseau Guy Denielou, qui commandait
le sous-marin, et l'ingénieur mécanicien de 1
ère classe Jacques Thomas, chef du service des machines,
arrivèrent péniblement à ce moment du
carré des officiers, distant de 5 ou 6 mètres.
Compte tenu de l'urgence de la situation, le commandant Dennielau
demanda à son ingénieur-mécanicien, qui
s'était hissé jusqu'au tableau de la chasse
principale, de se préparer à purger les ballasts
avant, de manière à donner au sous-marin une pointe
positive. Malheureusement, l'interphone étant toujours en
fonction, des bribes de l'échange verbal furent entendus
au poste avant. Le personnel de ce dernier comprit à tort
qu'il allait fermer la vanne d'air à haute pression allant
vers le central, si bien que la manœuvre de purger les
ballasts avant, ordonnée peu après par le
commandant, resta sans effet : le sous-marin continuait toujours
à descendre rapidement avec une forte pointe
négative. L'immersion de 100 mètres ayant
été dépassée, le commandant se
résolut à ordonner de purger tous les ballasts en
même temps. Une fois de plus, la manœuvre resta sans
effet. L'ingénieur mécanicien de 1ère classe
Thomas déclencha sans plus de résultats la chasse
générale de secours. Le drame put cependant
être évité. Monsieur Jacques Derny se
souvient du dénouement de cette situation en ces termes
:
« Je ne décris pas la consternation qui se
lisait sur les visages. C'est alors que nous avons entendu un
bruit de chasse haute pression dans les ballasts de l'avant. Il
était dû à la mise en œuvre par le
personnel du poste avant de la chasse située dans ce
poste. En effet, l'ordre répété par
l'ingénieur avait été diffusé
à son insu dans tout le bord par le réseau
d'interphone. Sous l'impulsion de cette chasse haute pression,
nous avons fait surface avec une forte pointe positive. ( ... ).
Parallèlement, les électriciens de quart dans le
compartiment des moteurs électriques [avaient] pris
l'initiative de réduire l'allure de Avant 4 à Avant
2, ce qui permit de limiter la perte d'immersion. ( ... ).
Personne au poste central ne s'était rendu compte de la
position des chadburns (compte tours) [1] qui ne se trouvaient
pas sur le tableau de plongée mais à 900 sur des
montants faisant face à l'arrière.
»
Une fois le déroulement de l'incident reconstitué
et analysé, le commandant décida de recréer
les mêmes conditions pour tester les réactions du
personnel de quart, qui, cette fois-ci, se comporta admirablement
et rétablit l'assiette du sous-marin vers 25- 30
mètres seulement. Après le retour au port du
sous-marin, l'Oberingenieur Tuschka, qui assurait lui-même
la maintenance et les réglages de ses appareils, vint
à bord de l'Artémis pour identifier la cause
précise de l'incident. Un mécanicien, d'origine
alsacienne, servait apparemment d'interprète entre
l'ingénieur allemand et les officiers du sous-marin.
Monsieur Henri Lucbert, ancien Premier Mécanicien ayant
embarqué sur l'Artémis fut témoin de
la visite de Friedrich Tuschka et rapporte un échange
savoureux entre ce dernier et le commandant du sous-marin :
« Que s'était-il passé ? Notre
ingénieur mécanicien, polytechnicien de formation,
voulant affiner certains réglages à
l'intérieur du boîtier Tuschka, avait dû faire
une fausse manipulation. Lorsque Tuschka vint à bord, il
constata que les scellés du boîtier avaient
été enlevés. Mécontent, il demanda au
commandant les raisons de ce geste. Ce dernier, comme il se doit,
défendit son ingénieur mécanicien. La
réponse de monsieur Tuschka fut alors la suivante:
Voyez-vous commandant, la France souffre de deux maux:
polytechnique et vérole. »
Monsieur Jacques Derny se souvient aussi de l'ingénieur
allemand Tuschka, « dont la tenue avec son short en cuir
de type bavarois ne passait pas inaperçu ».
Sur les sous-marins français Type Aurore/La
Créole, dont la conception remontait à
l'entre-deux-guerres, la commande des barres de plongée
était opérée grâce à un petit
moteur électrique installé à
proximité immédiate de ces mêmes barres,
l'ordre étant bien sûr donné avec un tableau
électrique au CO. Le problème résidait dans
la fragilité de ce système électrique ainsi
que le précisait Monsieur Jacques Derny:
« Ces barres ( ... ) comportaient en effet une armoire
de démarrage dans laquelle s'agitaient un nombre important
de relais pour chaque mouvement dans un sens ou dans l'autre.
»
Le Pilote automatique Tuschka, essentiellement une pièce
d'horlogerie mécanique, ne connaissait pas ces
problèmes et imposait aux commandes de barre, auxquelles
il était relié par deux électro-aimants de
bonne taille et des tiges mécaniques, un travail incessant
et contraignant qui causait ces pannes. Elles étaient donc
d' autant plus susceptibles de se produire lors d'une navigation
au Schnorchel, lorsque le sous-marin devait suivre au plus
près les mouvements de la surface de la mer. Il est
à noter que les sous-marins Type XXI allemands, dont le
système de commande de barre était hydraulique,
n'auraient sans doute pas connus de tels problèmes. Ils
furent d'ailleurs résolus sur les sous-marins
français Type Narval, à bord desquels la commande
de barre était hydraulique. Michel Pontrucher, ancien
Premier maître électricien ayant embarqué sur
le sous-marin La Créole à bord duquel fut
testé l'appareil Tuschka, estime que :
« Le concept [de la seconde commande NT et par
conséquent celle du PA] était beaucoup plus
élaboré que le précédent. On peut y
observer que : tout ce qui est périphérique de
l'action barre proprement dite a été pris en
considération et traité; soit, interactions entre
barres avant et arrière, correction de la pesée,
correction de l'assiette, phénomène de
renversement. On notera la prise d'information position safran au
plus près de celui-ci et donc hautement
sécuritaire. »
Par la suite, Friedrich Tuschka fonda sa propre
société, Tuschka Feinmechanik GmbH. Ses appareils
de tenue automatique de l'immersion allaient notamment
équiper à titre expérimental vers 1967 -
1968 les sous-marins classe 205 U-11
et U-12 de la République fédérale
d'Allemagne. En France, un second Pilote automatique fut ensuite
réalisé par le Département
Télécommandes du Centre national d'études
des télécommunications (CNET). L'emprunt à
la technologie allemande concernait l'indicateur et la commande
de profondeur, mai certaine fonctions étaient
désormais réalisées par des composants
électroniques. Les semi-conducteurs n'ayant pas encore
atteint le stade industriel, les composants utilisé
à I' époque étaient encore basiques : tube
à vide, triode, pentode. Ce PA français, qui fut
testé à partir de 1956 à bord du sous-marin
La Créole, possédait les positions
Montée et Descente. Il possédait cependant une
commutation automatique/semi-automatique à l'instar de la
commande NT allemande. Le PA pouvait en effet réaliser
l'ensemble des opérations ou se contenter d'effectuer le
calcul de l'angle de barre tandis qu'un barreur effectuait la
manœuvre. Enfin, de réglages de gain d'amplificateur
étaient désormais possible afin de donner au
système des réactions lentes ou rapides.
Le Bulletin d'information des sous-marins n°8 du premier
semestre 1957 précisait ainsi que: « [Le PA]
construit par le CNET et installé pour essais sur La
Créole a fonctionné pendant cent quatre vingt
heures en service courant de façon satisfaisante. Il
servira de prototype aux pilotes automatiques destinés aux
sous-marins Type Aréthuse et Daphné
».
- La société SAGEM poursuivit ensuite à son
compte les travaux du CNET et acquit après 1956-1957 un
quasi-monopole pour ce type d'appareils. En attendant la
validation puis la production de cette nouvelle version, les
sous-marins de la classe Narval conservèrent
approximativement jusqu'en 1961 un modèle
électromécanique antérieur, le PA4.
À bord du sous-marin Dauphin, l'échange fut
ainsi effectué au retour d'une mission en Juillet 1961.
Lorsque son réglage était effectué de
manière satisfaisante, le PA4, dont furent
équipés les quatre premiers sous-marins Type
Narval à partir du 01 Mai 1958, avait
présenté d'indéniables qualités. En
Juin-Juillet 1958, les sous-marins Dauphin et Requin effectuèrent ainsi
une croisière jusqu'aux Açores et
naviguèrent la plupart du temps en plongée. Le
lieutenant de vaisseau Burban, commandant du sous-marin
Requin, précisa dans le volet technique de son
rapport de mission quelle pouvait être l'utilité de
l'appareil de tenue automatique de l'immersion PA4
à bord d'un sous-marin destiné à
évoluer constamment en plongée:
« l'intérêt de cet appareil est
considérable. Il nous a permis de récupérer
deux hommes et d'effectuer ainsi une seconde veille microphonique
(DUUA) et un quart continu au poste torpilles. Le PA en immersion
a été utilisé pendant 50 jours à
quelques heures près. Nous avons dû le stopper en
effet une dizaine d'heures pour plusieurs avaries
légères ou pour entraînement des barreurs
».
- À l'immersion périscopique, par creux de 4
mètres ou supérieur, le PA était
équivalent à des barreurs moyens, mais dans les
autres situations, il était jugé
irréprochable. A l'immersion périscopique, par mer
de force 3 à 4, l'immersion était ainsi tenue
à 0,5 mètre près. Sa seule faiblesse
était de nécessiter des réglages parfois
complexes, à cause desquels l'appareil n'était pas
toujours apprécié par ses utilisateurs, loin de
là.
[1] Plutôt le T.T.O.M. Transmetteur d'ordre machine
(Auteur du site).
Pilote Tuschka PA2 sur La Créole(Collection Michel
Pontrucher)
Pilote Tuschka PA3 sur La Créole(Collection Michel
Pontrucher)
Représentation du Pilote Automatique Tuschka
(SAGEM)
Plan du Pilote Automatique Tuschka.
Selon une autre source : Premier essai en 1943 sur
l'U-555, première installation en série
début 1944 sur les U-235, U-236, U-867 ainsi qu'à partir de
l'automne 1944 sur les bateaux de front U-1017 (type VII C/41) et U-2511 (type XXI). Après
la guerre - développement pour la marine française
et pour la marine fédérale (classes 205 à
209). Aujourd'hui, ces installations mécaniques ont
été remplacées par des installations
électroniques.
Glossaire
Source : 1944-1954 SOUS-MARINS FRANÇAIS La
décennie du renouveau.

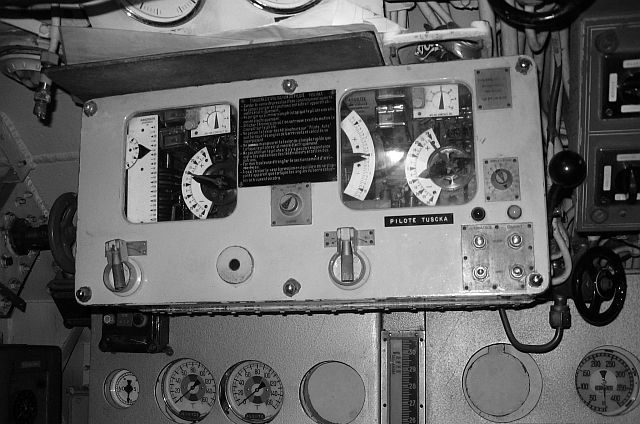
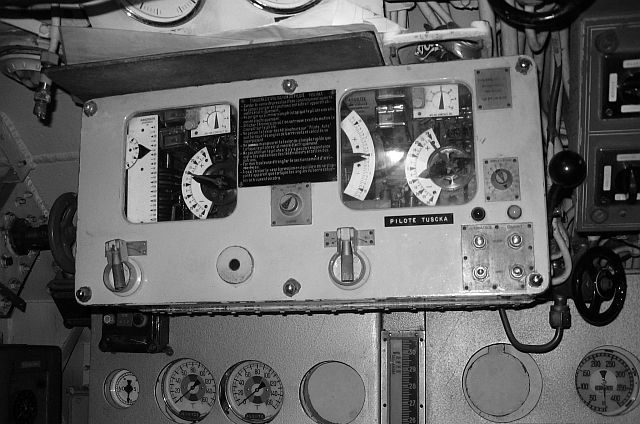
 . En 1939, la firme
avait également étudié pour le compte de
l'armée de Terre un système de pilotage pour les
fusées A4/V2
. En 1939, la firme
avait également étudié pour le compte de
l'armée de Terre un système de pilotage pour les
fusées A4/V2 utilisant des
gyroscopes. Ce dernier fut cependant abandonné au profit
de celui d'une firme concurrente, Kreiselgeräte GmbH. Ses
activités dans le domaine du guidage et des installations
hydrauliques avaient eu bien entendu des retombées dans le
domaine de la construction navale, en particulier dans la
construction des sous-marins et des torpilles : Askania avait
ainsi été amenée à réaliser
des appareils de tenue automatique de l'immersion, des appareils
de tenue automatique de pesée, des commandes hydrauliques
de périscope, de gouvernail, des traceurs de route,
différents organes de torpille, des moteurs de gouvernail
à air comprimé. À la suite des bombardements
successifs de Berlin en 1943, la section de l'Oberingenieur
Friedrich Tuschka, qui comprenait un bureau d'études et de
calculs, un laboratoire pour organes de réglages et de
mesures, ainsi qu'un atelier, avait été
délocalisée à Greiffenberg, petite ville de
Silésie. Devant l'avancée soviétique, la
direction de la firme Askania avait cependant
évacué une partie du personnel de Greiffenberg vers
Senthofen, dans l'Allgau, région autrichienne
occupée par la 1ère Armée française.
Au titre des réparations, les installations de Senthofen
furent saisies par l'armée française tandis que
l'Oberingenieur Friedrich Tuschka et une partie de es
collaborateurs furent recrutés par la Mission technique
permanente de la Marine nationale en Zone française
d'occupation. Dans un mémorandum de 1946, Friedrich
Tuschka décrivit avantageusement ses travaux au Service
technique des constructions et armes navales, par lequel il avait
été recruté, et ajouta les précisions
suivantes:
utilisant des
gyroscopes. Ce dernier fut cependant abandonné au profit
de celui d'une firme concurrente, Kreiselgeräte GmbH. Ses
activités dans le domaine du guidage et des installations
hydrauliques avaient eu bien entendu des retombées dans le
domaine de la construction navale, en particulier dans la
construction des sous-marins et des torpilles : Askania avait
ainsi été amenée à réaliser
des appareils de tenue automatique de l'immersion, des appareils
de tenue automatique de pesée, des commandes hydrauliques
de périscope, de gouvernail, des traceurs de route,
différents organes de torpille, des moteurs de gouvernail
à air comprimé. À la suite des bombardements
successifs de Berlin en 1943, la section de l'Oberingenieur
Friedrich Tuschka, qui comprenait un bureau d'études et de
calculs, un laboratoire pour organes de réglages et de
mesures, ainsi qu'un atelier, avait été
délocalisée à Greiffenberg, petite ville de
Silésie. Devant l'avancée soviétique, la
direction de la firme Askania avait cependant
évacué une partie du personnel de Greiffenberg vers
Senthofen, dans l'Allgau, région autrichienne
occupée par la 1ère Armée française.
Au titre des réparations, les installations de Senthofen
furent saisies par l'armée française tandis que
l'Oberingenieur Friedrich Tuschka et une partie de es
collaborateurs furent recrutés par la Mission technique
permanente de la Marine nationale en Zone française
d'occupation. Dans un mémorandum de 1946, Friedrich
Tuschka décrivit avantageusement ses travaux au Service
technique des constructions et armes navales, par lequel il avait
été recruté, et ajouta les précisions
suivantes: et mettant en jeu de gyroscopes et des
composants issus des études aéronautiques fut
testé en laboratoire en 1941. Jugé insuffisant, il
ne serait cependant jamais installé à bord: si la
course du sous-marin avait effectivement pu être maintenue,
l'immersion et ses variations n'étaient pas prises en
compte. L'expérience acquise permit toutefois le
développement d'un système entièrement
nouveau baptisé commande NT - Neigung und
Tiefensteuerung (assiette et immersion). Le premier composant
de la commande NT était un tuyautage de mesure aboutissant
à une chambre à membrane. À
l'intérieur de cette dernière, la pression
compressait une membrane dite d'immersion et mettait un ressort
sous tension. Le maintien de l'immersion était
opéré par réglage de la tension du ressort.
Les variations d'immersion pouvaient être
opérées entre 10 et 150 mètres, avec un
écart possible de 2 mètres. Quant à
l'assiette du sous-marin, elle était tout simplement
contrôlée grâce à un système de
pendule placé sur des suspensions à ressort afin de
résister aux grenadages. Les données recueillies
par ces deux appareils étaient transmises à de
engrenage calculateur eux-mêmes reliés au gouvernail
et aux barres de plongée. Ces engrenages calculateur
constituaient le cœur de la commande NT et furent l'objet
d'une mise au point délicate, en particulier celui
appelé système à avance, qui
générait une dérivée - et permettait
d'appréhender une situation au vu de
l'accélération du mouvement. Grâce à
la commande NT, le sous-marin pouvait efficacement maintenir ou
modifier son immersion à diverses allures. L'U-555, un sous-marin du type VII
C, fut le premier navire à recevoir en 1942 cette commande
expérimentale. À cette même période,
l'utilité d'un appareil de tenue automatique de
l'immersion augmenta, les sous-marins allemands étant
contraints d'évoluer en plongée d'une
manière croissante. En permettant aux sous-marins de
recharger leurs batteries électriques ou de transiter en
plongée, l'adoption du Schnorchel avait
confirmé cette évolution mais impliquait une charge
de travail accrue et particulièrement épuisante
pour le personnel chargé du maniement des barre de
plongée avant et arrière du sous-marin. Lors de la
navigation au Schnorchel, il fallait pouvoir maintenir
durant de longues heures le sous-marin à une immersion
constante, ou tout au plus avec des variations maximum de 0,50
mètre. Si la tête du Schnorchel
émergeait d'une manière trop importante au-dessus
des vagues, elle pouvait être plus facilement
détectée par un radar et révéler la
position du sous-marin. Un second modèle de commande NT
fut ensuite étudié pour les sous-marins des Types
XXI et XXIII. Dans la mesure où, pour une vitesse
supérieure à 6 nœuds, les seules barres de
plongée arrière suffisaient à modifier
l'immersion efficacement, les barres avant devenaient inutiles et
étaient rétractées dans le cas du Type XXI,
soit mises en position neutre et immobilisées comme sur le
Type XXIII. Cette disposition répondait également
au souci de diminuer la résistance à l'avancement
et de gagner quelques nœuds. La nouvelle commande NT fut
donc reliée au dispositif de déploiement des barres
de plongée avant.
et mettant en jeu de gyroscopes et des
composants issus des études aéronautiques fut
testé en laboratoire en 1941. Jugé insuffisant, il
ne serait cependant jamais installé à bord: si la
course du sous-marin avait effectivement pu être maintenue,
l'immersion et ses variations n'étaient pas prises en
compte. L'expérience acquise permit toutefois le
développement d'un système entièrement
nouveau baptisé commande NT - Neigung und
Tiefensteuerung (assiette et immersion). Le premier composant
de la commande NT était un tuyautage de mesure aboutissant
à une chambre à membrane. À
l'intérieur de cette dernière, la pression
compressait une membrane dite d'immersion et mettait un ressort
sous tension. Le maintien de l'immersion était
opéré par réglage de la tension du ressort.
Les variations d'immersion pouvaient être
opérées entre 10 et 150 mètres, avec un
écart possible de 2 mètres. Quant à
l'assiette du sous-marin, elle était tout simplement
contrôlée grâce à un système de
pendule placé sur des suspensions à ressort afin de
résister aux grenadages. Les données recueillies
par ces deux appareils étaient transmises à de
engrenage calculateur eux-mêmes reliés au gouvernail
et aux barres de plongée. Ces engrenages calculateur
constituaient le cœur de la commande NT et furent l'objet
d'une mise au point délicate, en particulier celui
appelé système à avance, qui
générait une dérivée - et permettait
d'appréhender une situation au vu de
l'accélération du mouvement. Grâce à
la commande NT, le sous-marin pouvait efficacement maintenir ou
modifier son immersion à diverses allures. L'U-555, un sous-marin du type VII
C, fut le premier navire à recevoir en 1942 cette commande
expérimentale. À cette même période,
l'utilité d'un appareil de tenue automatique de
l'immersion augmenta, les sous-marins allemands étant
contraints d'évoluer en plongée d'une
manière croissante. En permettant aux sous-marins de
recharger leurs batteries électriques ou de transiter en
plongée, l'adoption du Schnorchel avait
confirmé cette évolution mais impliquait une charge
de travail accrue et particulièrement épuisante
pour le personnel chargé du maniement des barre de
plongée avant et arrière du sous-marin. Lors de la
navigation au Schnorchel, il fallait pouvoir maintenir
durant de longues heures le sous-marin à une immersion
constante, ou tout au plus avec des variations maximum de 0,50
mètre. Si la tête du Schnorchel
émergeait d'une manière trop importante au-dessus
des vagues, elle pouvait être plus facilement
détectée par un radar et révéler la
position du sous-marin. Un second modèle de commande NT
fut ensuite étudié pour les sous-marins des Types
XXI et XXIII. Dans la mesure où, pour une vitesse
supérieure à 6 nœuds, les seules barres de
plongée arrière suffisaient à modifier
l'immersion efficacement, les barres avant devenaient inutiles et
étaient rétractées dans le cas du Type XXI,
soit mises en position neutre et immobilisées comme sur le
Type XXIII. Cette disposition répondait également
au souci de diminuer la résistance à l'avancement
et de gagner quelques nœuds. La nouvelle commande NT fut
donc reliée au dispositif de déploiement des barres
de plongée avant.